
Il y a peu, j’ai eu la chance de découvrir l’exposition « Le goût de la parure. Portraits du château de Versailles« , présentée dans le logis du roi René au château d’Angers. Pourquoi une exposition en Anjou alors qu’il s’agit de portraits de Versailles, me direz-vous ? Et bien car depuis 2013, un partenariat signé entre le Centre des monuments nationaux et l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, permet par le biais d’expositions temporaires, de présenter dans divers monuments nationaux français les trésors des collections de Versailles. Cette exposition autour du goût de la parure est le quatrième volet de ce partenariat.
Je dois bien avouer que le thème de cette exposition m’a enchanté. Une quarantaine de peintures et d’estampes du château de Versailles ont ainsi été sélectionnées. Ces portraits allant du XVIIe au XIXe siècle retracent l’histoire du goût de la parure et permettent de se rendre compte de l’importance de l’apparence pour les princes et courtisans. Ces représentations sont d’autant plus précieuses car il ne reste que très peu de parures historiques anciennes. En effet, les joyaux de la Couronne ont été dérobés en 1792, une grande partie a été revendue et dispersée.
L’exposition se présente donc en trois sections, trois périodes :
- le Grand Siècle ;
- le siècle des Lumières ;
- le faste du Second Empire.

LE GOÛT DE LA PARURE À LA COUR DU ROI-SOLEIL
Notre bon cher Louis XIV avait une passion bien connue et plutôt coûteuse, les diamants ! Une passion qui le conduit à enrichir considérablement la collection des diamants de la Couronne. Les pierres précieuses occupent une place essentielle dans la constitution des parures. Les aigrettes, épingles, boutons constituent de très beaux éléments décoratifs.
Les bijoux et les pierres contribuent à la richesse et à l’harmonie de la tenue vestimentaire. Les diamants montés en parure ornent l’habit, les boucles de chaussures, le chapeau et la poignée d’épée.

Claude Lefèvre – Louis XIV, roi de France, vers 1660 

Les bijoux vont de pair avec la position occupée à la cour ; les apparences vestimentaires construisent le rang social, confirment le niveau de fortune et révèlent le pouvoir.

Charles et Henri Beaubrun – Anne d’Autriche, reine de France, vers 1660 
Charles et Henri Beaubrun – Anne de Rohant-Chabot, princesse de Soubise, vers 1660-1670
Arborer ses richesses, c’est participer au spectacle donné à Versailles et à la mise en scène de la pompe royale : l’or, l’argent et les gemmes correspondent à l’esthétique du Roi-Soleil.


LE GOÛT DE LA PARURE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Dans cette section, nous passons du règne de Louis XV et des figures royales portant les Joyaux de la Couronne à la représentation des princesses sous Louis XVI qui cèdent à la mode néo-grecque. Au XVIIIe siècle, les joailliers parisiens gagnent un grand renom suite à une réputation bien établie. Toujours dans la création afin de satisfaire une clientèle avide de nouveautés, ils inventent sans cesse de nouveaux modèles. La joaillerie française devient un modèle pour toute l’Europe. Cette section souligne les points communs d’une cour à l’autre, en particulier celles de France, d’Autriche et d’Espagne dans la création et le goût.

Louis XV commande plusieurs ornements orfévrés considérés comme de véritables chefs-d’oeuvre et réalisés avec les plus belles pierres du Trésor royal. Louis XVI lui, les fait démonter dans l’intention d’en faire retailler les diamants.

Louis Michel Van Loo – Philippe V d’Espagne, vers 1743 
Louis Michel Van Loo – Élisabeth Farnèse, reine d’Espagne, vers 1743

Sous le règne de Philippe V, l’art de cour acquit un caractère français prononcé. C’était aux joailliers parisiens que le souverain avait l’habitude de commander ses parures orfévrées.

Adélaïde Labille-Guiard – Élisabeth Philippe Marie Hélène de France, dite Madame Élisabeth, vers 1788 
Élisabeth Louise Vigée Le Brun – Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse d’Orléans, vers 1789
LE GOÛT DE LA PARURE À L’ÈRE DES GRANDS BOULEVERSEMENTS
Le goût de la parure renaît après la Révolution, mais celle-ci ayant dispersé les collections de bijoux, il faut reconstituer ce trésor ainsi que les cassettes des femmes à la mode. Pauline Borghèse, la plus coquette des soeurs de Napoléon (et sa préférée !), symbolise au début de l’Empire ce renouveau pour la parure et les bijoux. Le second mariage de l’Empereur avec l’archiduchesse Marie-Louise donne également lieu à de nombreux achats et commandes pour étoffer le nouveau trésor des Diamants de la Couronne. Il en sera de même lors de la restauration des Bourbons avec le règne de Louis XVIII. En parallèle, la ville s’intéresse aussi à la parure, notamment avec les femmes qui tiennent salon.



Jean-Baptiste Paulin Guérin – Marie-Caroline, duchesse de Berry, vers 1825 
Joseph Boniface Franque – Marie-Louise, impératrice des Français et le roi de Rome, 1812



Louis Hersent – Sophie Gay, née Nichault de La Valette, 1824 
Édouard Dubufe – Eugénie de Montijo de Guzman, impératrice des Français, 1854
INFORMATIONS PRATIQUES
Jours d’ouverture et horaires
- ouvert tous les jours sauf le 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre
- du 2 janvier au 30 avril : 10h-17h30
- du 2 mai au 4 septembre : 9h30-18h30
- du 5 septembre au 31 décembre : 10h-17h30
.
Tarifs
- plein tarif : 9€
- tarif réduit : 7€
- gratuit pour les – de 25 ans
.




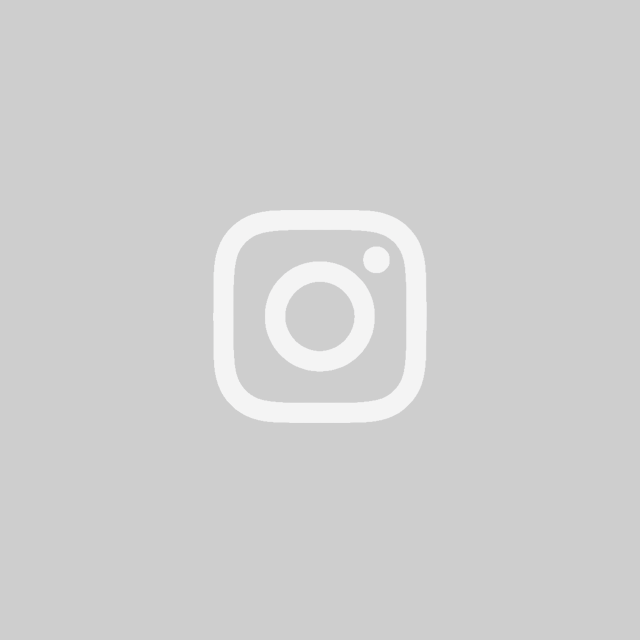

Laisser un commentaire